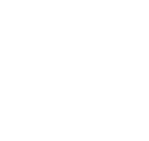Préservation de la fertilité féminine
Préservation de la fertilité pour raisons médicales
En France, l’accès à la préservation de la fertilité est garanti par la loi de bioéthique qui prévoit que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle. »
Ainsi, dans le contexte de maladies cancéreuses dont les traitements peuvent altérer la fertilité (chimiothérapies…) ou de pathologies non cancéreuses comme l’endométriose ou la présence de kyste ovariens nécessitant un geste chirurgical, il est possible de recourir aux techniques de préservation de la fertilité, si toutefois les conditions concernant la faisabilité technique et médicale sont réunies.
La préservation de la fertilité pour raisons médicales concerne les maladies cancéreuses ou non cancéreuses (kystes ovariens, endométriose…) dont la prise en charge présente un risque pour la fertilité ultérieure.
2 techniques de préservation de la fertilité féminine existent :
- La vitrification ovocytaire
- La cryoconservation de tissu ovarien
La vitrification ovocytaire
Elle consiste en une stimulation hormonale à fortes doses, dans l’objectif de faire grossir un maximum de follicules sur les ovaires. Cette stimulation se fait par des injections sous-cutanées quotidiennes pendant 11 à 15 jours. Des contrôles échographiques et par prise de sang sont effectués à plusieurs reprises lors de cette période. Quand les tailles folliculaires sont satisfaisantes, la maturation folliculaire finale est déclenchée et les ovocytes sont récupérés environ 36h plus tard au bloc opératoire, sous contrôle échographique et sédation anesthésique. Le liquide folliculaire est ensuite transmis au laboratoire de biologie de la reproduction, qui congèle les ovocytes ainsi obtenus.
L’objectif est de pouvoir utiliser les ovocytes ultérieurement, si un projet de grossesse est présent mais que la réserve ovarienne après traitements ne permet pas de récupérer une fonction de reproduction satisfaisante. Il est alors pratiqué une fécondation in vitro avec les spermatozoïdes du partenaire ou d’un donneur. Le ou les embryons ainsi obtenus peuvent ensuite être transféré(s) dans l’utérus de la patiente, en vue d’obtenir une grossesse.
Il est possible que l’on propose d’enchaîner plusieurs cycles de stimulation afin d’augmenter le nombre d’ovocytes congelés avant traitement.
En moyenne, 10 ovocytes congelés permettent environ 50% de chances de grossesse ultérieures.
La cryoconservation de tissu ovarien
Elle peut être proposée :
- aux patientes (petite fille, jeune fille pré-pubère et adulte jusqu’à 35 ans) devant recevoir un traitement hautement gonadotoxique
- aux patientes adultes ayant une contre-indication à la stimulation ovarienne
Elle consiste en l’ablation d’un ovaire (ou demi-ovaire) par coelioscopie sous anesthésie générale, et conservation des fragments ovariens prélevés par congélation très rapide dans l’azote liquide.
Elle ne nécessite pas de stimulation hormonale.
L’objectif est de pouvoir replacer les fragments ovariens ultérieurement, si un projet de grossesse est présent mais que la réserve ovarienne après traitements ne permet pas de récupérer une fonction de reproduction satisfaisante.
Pour ces 2 types de prise en charge, le médecin qui suit la patiente doit prendre contact avec Emmanuelle D’ORAZIO, sage-femme coordonnatrice de la préservation de la fertilité dans notre centre, via un formulaire de demande spécifique.
En cas de préservation de la fertilité chez l’enfant pré-pubère, le médecin qui suit l’enfant doit prendre contact avec le Dr Laura Keller, biologiste au laboratoire de biologie de la reproduction.
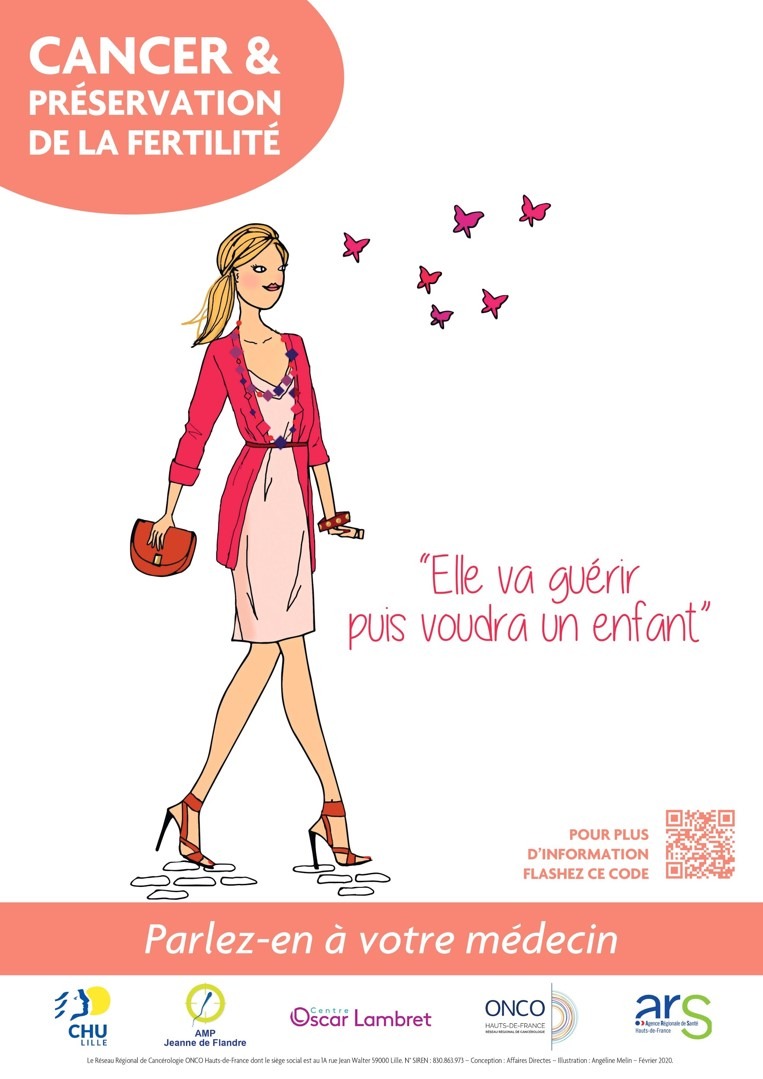
Préservation de la fertilité pour raisons non médicales
La loi de bioéthique de 2021 prévoit la possibilité d’autoconserver ses gamètes sans condition médicale et sans condition de don d’une partie des gamètes à autrui.
Il faut néanmoins remplir des conditions d’âge pour pouvoir autoconserver ses gamètes : à partir de 29 ans pour les femmes et avant 37 ans. Le principe est ensuite celui d’une vitrification ovocytaire (voir ci-dessus). Des frais annuels de conservation sont à votre charge.
Prendre rendez-vous : Remplir la Fiche de renseignements; lire, compléter et signer la Notice d’information et transmettre les 2 documents à pmapourtoutes@chu-lille.fr
Préservation de la fertilité masculine
Préservation de la fertilité pour raisons médicales
« Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée … » peut bénéficier d’une préservation de la fertilité.
2 techniques existent :
- La congélation de spermatozoïdes éjaculés ou obtenus après une extraction chirurgicale
- La cryoconservation de tissu testiculaire pré-pubère
La congélation de spermatozoïdes :
La congélation de spermatozoïdes éjaculés est proposé aux hommes et jeunes garçons dès la puberté, le recueil du sperme s’effectue alors par masturbation.
La congélation de spermatozoïdes après extraction chirurgicale est proposée lorsque le recueil par masturbation n’est pas possible ou que l’examen du sperme éjaculé n’a pas mis en évidence de spermatozoïdes. Il s’agit alors d’aller prélever un fragment de testicule, sous anesthésie générale au bloc opératoire, on appelle ce prélèvement une biopsie testiculaire.
Le recueil (ou la biopsie testiculaire) est ensuite analysé au laboratoire (nombre et mobilité des spermatozoïdes) avant d’être congelé dans plusieurs contenants ressemblant à des petites pailles. Ces pailles sont ensuite conservées dans l’azote liquide.
L’objectif est de pouvoir utiliser les spermatozoïdes ultérieurement, si un projet de grossesse est présent mais que les testicules ne produisent plus de spermatozoïdes. Il est alors réalisé une Fécondation In Vitro (FIV) avec les spermatozoïdes décongelés après avoir récupéré les ovules de la partenaire ou d’une donneuse. Le ou les embryons ainsi obtenus peuvent ensuite être transféré(s) dans l’utérus de la conjointe, en vue d’obtenir une grossesse.
Pour prendre RDV vous pouvez contacter le CECOS : cecos@chu-lille.fr
La cryoconservation de tissu testiculaire
Elle peut être proposée aux patients (petit garçon, jeune garçon pré-pubère ou péri-pubère) devant recevoir un traitement hautement gonadotoxique.
Elle consiste en un prélèvement d’un petit morceau de tissu testiculaire, sous anesthésie générale. Les fragments obtenus sont ensuite congelés et conservés dans l’azote liquide. Avec cette technique on ne conserve pas de spermatozoïdes, car avant la puberté les testicules ne sont pas encore en capacité de les produire.
En cas de préservation de la fertilité chez l’enfant pré-pubère, le médecin qui suit l’enfant doit prendre contact avec le Dr Laura Keller, biologiste au laboratoire de biologie de la reproduction.

Préservation de la fertilité pour raisons non médicales
La loi de bioéthique de 2021 prévoit la possibilité d’autoconserver ses gamètes sans condition médicale et sans condition de don d’une partie des gamètes à autrui.
Il faut néanmoins remplir des conditions d’âge pour pouvoir autoconserver ses gamètes : à partir de 29 ans pour les hommes et avant 45 ans. Le principe est ensuite celui d’une congélation de spermatozoïdes éjaculés (voir ci-dessus). Des frais annuels de conservation sont alors à votre charge.
Pour prendre RDV vous pouvez contacter le CECOS : cecos@chu-lille.fr